Le reseau : conséquence ideologique de l’anarchosyndicalisme ?
Publié le 22 novembre 2010

Force est de constater que les questions sur l’organisation continuent chez
les révolutionnaires et, plus particulièrement, chez les anarchosyndicalistes
de la CNT-AIT à animer des débats. L’une d’entre-elles porte sur le
réseau. D’après ses détracteurs, il serait « marginal dans les milieux libertaires
ou anarchistes » (expression qui ne veut pas dire grand-chose, mais
le galimatias est à la mode) ou, plus précisément, « il serait même complètement
étranger à ces milieux ». Au passage, soulevons deux remarques :
- 1 : Vouloir amalgamer l’anarchosyndicalisme avec ces milieux, c’est ne
pas comprendre ce qui le singularise. L’anarchosyndicalisme en effet s’appuie
sur cette conception matérialiste de l’Histoire qui, certes, avance le
concept de la lutte des classes, mais il veut de plus aborder le champ social
dans son entière complexité et totalité ou, si l’on veut, dans une critique unitaire
de ce monde. En effet, il s’érige contre toute parcellisation de la lutte
qui entraîne une spécialisation dans un thème contestataire. Sur le plan
gnoséologique (théorie de la connaissance), cela aboutit à un réductionnisme
cognitif. C’est-à-dire que l’on n’analyse le champ social qu’au travers du
filtre de sa propre spécialisation contestataire. Partant de là, l’anarchosyndicalisme
s’oppose au clivage de l’économie et de la politique, par exemple,
clivage qui conduit à concevoir comme étant indépassable ce schéma
organisationnel : l’organisation syndicale d’un côté et l’organisation spécifique
de l’autre.
- 2 : Soutenir cette idée d’étrangeté du réseau ne fait, à mes yeux, qu’illustrer
une lacune ou, ce qui est beaucoup plus grave, une méconnaissance de
l’Histoire de l’anarchosyndicalisme. Or, que nous dit cette Histoire de l’anarchosyndicalisme
qui varie selon les pays ? Voici l’exemple de
l’Allemagne.
Retour sur un contexte
Les vicissitudes de la 1re Guerre
mondiale favorisent la sédition contre
la monarchie. Le 30 octobre 1918, les
marins de Kiel se mutinent. Le 5
novembre 1918, la grève générale
éclate dans la même ville, le jour suivant
à Hambourg, ce qui débouche
sur un soulèvement et un processus
révolutionnaire, menés sous la houlette
du mouvement des conseils
d’ouvriers et de soldats. Le 9 novembre
1918, la République Allemande et
la République socialiste libre
d’Allemagne sont proclamées, à deux
heures d’intervalle, par Scheidemann
(SPD : Parti social-démocrate d’Allemagne)
et Liebknecht (Ligue Spartakiste).
La social-démocratie est prise
de court, mais pas pour très longtemps.
En effet, elle bénéficie encore
d’une influence idéologique assez
importante. Pendant le premier
congrès du mouvement des conseils
d’ouvriers et de soldats, entre le 16 et
21 décembre 1918, elle réussit à obtenir
la majorité. Elle dévoie le mouvement
vers la collaboration de classe et
le parlementarisme et crée l’Assemblée
nationale constituante allemande.
D’autre part, Noske (SPD) écrase
l’insurrection spartakiste de Berlin de
janvier 1919 et ordonne aux Corps
francs (Freikorps, milice de la droite
nationaliste) d’exécuter Liebnecht et
Rosa Luxemburg le 15 janvier 1919.
Avec à leur tête le général Franz Epp,
les Corps francs se chargent de mater
trois mois plus tard la République des
Conseils de Bavière. Le 31 juillet
1919, l’Assemblée nationale constituante
allemande adopte la constitution
de Weimar qui fonde la
République de Weimar. En 1919, le
Traité de Versailles impose à
l’Allemagne des conditions qui vont
pousser son économie dans l’abîme
(le montant écrasant des dédommagements
de guerre, par exemple).
En 1923, c’est l’hyperinflation et
l’armée française occupe le bassin
industriel de la Ruhr jusqu’en 1924
(elle fait pression pour que son capitalisme
puisse redémarrer). Cependant,
le quinquennat doré (1924-29)
marque le retour d’une prospérité économique
et d’une stabilité politique.
La crise d’octobre 1929 éclate, elle
annonce la grande dépression des
années 30.
le NSDAP
parti national socialiste
des travailleurs allemands
En marge, le NSDAP - dont l’idéologie
puise à la fois dans l’antisémitisme,
le paganisme, le nationalisme et
le bolchevisme - tente de profiter de
l’opprobre suscitée par l’effondrement
du Mark et l’occupation de la Ruhr
pour s’emparer du pouvoir à Munich,
en Bavière, dans la soirée du 8
novembre 1923, car il espère entamer
une marche sur Berlin, à l’instar des
Chemises noires de Mussolini. Le
lendemain, c’est l’échec complet. Le
« Putsch de la Brasserie » vaut à
Hitler un deuxième séjour en prison
(celui-ci, de treize mois). Hitler va
dès lors renoncer à l’illégalisme révolutionnaire
pour miser sur le légalisme
électoraliste. En son absence, le
NSDAP éclate en deux tendances.
Dès sa sortie de prison, Hitler le remet
sur pied. Il s’emploie aussi à éradiquer
l’aile gauche, incarnée par les frères
Strasser [1], Goebbels et Röhm (chef de
la SA - Section d’Assaut). Hitler veut
s’assurer le ralliement des hautes
sphères : financières, industrielles,
militaires. Avec la grande dépression
des années 30, les succès électoraux
s’enchaînent et confortent Hitler dans
sa ligne politique. Néanmoins, ceux
du 31 juillet 1932 sont décevants.
L’affaire de Potempa [2] n’arrange rien.
Le NSDAP est pris dans une tourmente.
Après des tractations pour se
ménager la susceptibilité d’Hindenburg [3], le vieux maréchal décide de
nommer Hitler chancelier de la
République de Weimar, le 30 janvier
1933 [4]. Hitler ne rencontre pas le
moindre signe d’une agitation prolétarienne
de masse. C’est bientôt la fin
de la République de Weimar.
La FAUD
union libre des
travailleurs allemands
Le congrès constitutif de la FAUD
se tient à Berlin entre le 27 et 30
décembre 1919. La FAUD se veut
une organisation révolutionnaire antiparlementariste,
anti-étatique et anarchosyndicaliste.
Elle compte en son
sein des propagandistes de renom
comme Rocker, Lehning, Souchy et
Rüdiger. La FAUD joue un rôle très important dans le soulèvement et le
processus révolutionnaire de la Ruhr
(faisant suite à la grève générale qui
dure), dans le sillage d’une grève
générale de quatre jours dans toute
l’Allemagne. C’est la réponse des travailleurs
au putsch de Kapp, à Berlin,
le 13 mars 1920. Dans la Ruhr, on
assiste à la création d’une Armée
Rouge (composée à moitié d’anarchosyndicalistes),
à la mise
en place des collectivisations
(les transports et
les entreprises de tisane
à Mühlheim, par exemple)
et des conseils d’ouvriers
et de soldats.
L’armée et les Corps
francs rétablissent l’ordre
dans la région (quand
ce n’est pas l’armée française
qui s’en charge en
1923-24).
Même avant l’arrivée
au pouvoir du NSDAP,
la répression contre la
FAUD sera une constante
: interdiction de
ces unions locales en Westphalie,
Saxe, Mecklenburg, Pommern. Elle
l’est même complètement en Bavière.
Ce qui ne l’empêche pas d’agir pour
l’augmentation des salaires et obtenir
des meilleures conditions de travail,
ou contre le chômage, voire de
relayer et mener la campagne pour la
libération de Sacco et Vanzetti.
En 1932, la FAUD est la seule
organisation subversive encore capable
de regrouper plusieurs milliers de
membres. Mais elle ne peut à elle
seule déclencher la grève générale
pour contrer le NSDAP. D’ailleurs,
ses appels restent lettre morte. A
Pâques, le dernier congrès officiel des
anarchosyndicalistes de la FAUD se
déroule à Erfut : ceux-ci se préparent
à entrer dans la clandestinité ou à
choisir le chemin de l’exil.
Dans la nuit du 27 au 28 février
1933, le Reichstag brûle. Il sert de
prétexte à Hitler. En mars 1933, le
siège de la FAUD à Berlin est perquisitionné
: les anarchosyndicalistes
présents sont arrêtés et tout le matériel
est saisi, y compris les archives de
l’AIT. C’est le signal de la première
grande vague de répression contre la
FAUD sous le régime nazi. La FAUD
parvient assez rapidement à se réorganiser
et à élaborer un axe d’intervention
selon ce triptyque :
- 1 : L’organisation extérieure qui est
le « Bureau de l’émigration », siégeant
à Amsterdam (il accueille aussi
le bureau de l’AIT mais temporairement,
car il est transféré ensuite à
Madrid). Il n’est qu’un lieu de transit
pour beaucoup d’anarchosyndicalistes
qui partent en direction de l’Espagne
pour combattre aux côtés de la CNT.
Ils se rassemblent dans le DAS (Deustche AnarchoSyndikalisten).
Ceci dit, ceux qui décident de rester
mettent en place un centre d’émigration
de la FAUD qui est un réseau. Ils
récoltent aussi des fonds de soutien et
éditent du matériel de propagande
pour l’envoyer vers l’Allemagne.
- 2 : L’organisation intérieure qui comprend
le « Comité de coordination
clandestin » et les groupes locaux de
la FAUD. Celui-ci est transféré d’abord
à Erfut, ensuite à Leibzig. Sa
fonction est d’assurer la liaison entre
l’organisation extérieure et celle de
l’intérieur, voire la coordination entre
toutes les entités.
- 3 : Les « Groupes autonomes antifascistes
» dans le sens où ils agissent
entièrement par eux-mêmes et n’ont
aucun rapport entre eux afin d’échapper
à la Gestapo. Cependant, la sclérose
n’est-elle pas la contrepartie ?
Est-ce que c’est cette raison qui pousse
certains de ces groupes à nouer des
liens avec la FAUD ? En tous cas, un
réseau de résistance prend forme en
recoupant les anciennes zones d’influence
de la FAUD (Rhin-main,
Saxe, Thuringe, Rhénanie,
Hambourg, Berlin).
Mais la FAUD est confrontée à
ces trois grandes difficultés :
- 1 : La situation économique change en 1935 et nombre d’anarchosyndicalistes
retrouvent du travail après une
longue période de chômage. Ils
renoncent à toute activité, car ils
savent que la Gestapo les suit à la
trace et récolte des informations
auprès de leurs employeurs. C’est la
peur d’être licencié ou de se faire
dénoncer par le collègue de travail.
- 2 : La répression s’exerce avec encore
plus d’acharnement
et s’accompagne de la
brutalité inhérente au
régime nazi (son système
concentrationnaire,
par exemple).
Toute une série de
procès (au nombre de
sept, pour cinq à quarante
inculpés, et un
autre pour cent inculpés)
se déroulent en
1936. Ce n’est guère
mieux en 1937...
- 3 : Le problème des
livraisons de la presse
militante se pose à
partir de fin 1934 -
début 1935. Cette presse militante
permet de maintenir la cohésion entre
les groupes de la FAUD.
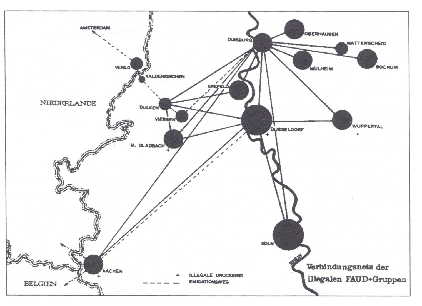
Le réseau de la Rhénanie du
nord-Westphalie
Nous pouvons constater que
deux filières d’émigration sont constituées
:
- 1 : Düsseldorf, Aachen (Aix-la-
Chappelle), en direction de la
Hollande ou de la Belgique,
- 2 : Duisburg, Viersen, Dulken,
Kaldenkirchen, Venlo (ville frontalière
hollandaise d’accueil, d’où l’on
part pour Amsterdam où se trouve le
bureau d’émigration de la FAUD). En
fait, cette filière est déjà pensée en
1932. Son point névralgique est
Duisburg. L’appartement de Julius
Nolden sert de plaque tournante pour
recevoir les anarchosyndicalistes
fuyant le pays, particulièrement le
centre. Ce compagnon contribue
grandement à structurer ce réseau,
grâce à sa position acquise au sein de
la FAUD [5]. Julius Nolden remplace
Franz Bungert [6] à la région. Julius
Nolden n’utilise que la bicyclette
comme moyen de locomotion et n’agit
que sous le couvert de « la caisse
funéraire pour le droit à l’incinération
» [7]. Notons également le rôle
important d’un certain germano-hollandais Derksen, ce compagnon possède
une bonne connaissance de la
zone frontalière. Ce qui évite, en cas
d’urgence, de passer par le point de
Dulken.
Cette même filière sert aussi pour
le matériel de propagande, stocké et
dissimulé chez la famille du compagnon
Derksen, avant de gagner
Duisburg qui dispatche par ses faisceaux
vers les villes telles que
Wattenscheid, Bochum, Mülheim,
par exemple. En août 1933, les anarchosyndicalistes
de la FAUD inaugurent
le système de diffusion. Le rythme
des livraisons est assez constant
jusqu’à fin 1934 - début 1935
(suspension des livraisons de la presse).
Pour l’anecdote, d’après les rapports
judiciaires, la brochure
« Mangez des fruits allemands et
vous serez en bonne santé » (titre de
camouflage d’une brochure anarchosyndicaliste)
acquiert une popularité
chez les mineurs - qui s’apostrophent
mutuellement comme suit : « As-tu
mangé aussi des fruits allemands ? »
En 1936, l’engouement pour la
révolution espagnole annonce une
reprise, mais de courte durée. Julius
Nolden s’active à multiplier les
contacts, les déplacements et les
réunions pour organiser la solidarité.
Quant à Simon Wehren d’Aachen, il
s’emploie à chercher des spécialistes
pour qu’ils aillent prêter main forte à
la révolution.
En décembre 1936, la Gestapo
réussit à infiltrer l’organisation intérieure.
Début 1937, la Gestapo frappe
simultanément ces trois points névralgiques
du réseau : Duisburg,
Düsseldorf et Köln, qui présentent la
particularité avec ceux de Wuppertal,
Krefeld, Dulken, Viersen, Mönchengladbach
et d’Aachen d’être agencé en
« triade », par des liens en faisceaux.
Quatre-vingt neuf anarchosyndicalistes,
parmi lesquels Julius Nolden [8],
sont mis sous les verrous. Le réseau
de la Rhénanie du Nord-Westphalie
est anéanti.
Considérations
L’Histoire de l’anarchosyndicalisme
est ainsi faite et nul ne peut prétendre
à la réécrire tout comme
l’Histoire, à moins de se complaire
dans la spéculation enivrante.
L’expérience de la FAUD dans sa
lutte contre le régime nazi nous prouve :
- 1 : Que le réseau est bien une forme d’organisation adoptée par les anarchosyndicalistes.
Il inclut l’appui
mutuel et la solidarité (« qui est une
démarche volontaire et non une
contrainte imposée par une majorité
» - il est utile de le rappeler [9]).
- 2 : Que le réseau permet de maintenir
une cohésion entre tous les groupes
qui le composent et, par là même, de
susciter une dynamique, voire de
coordonner l’action entre eux. Grâce à
son organisation en réseau, la FAUD
s’est maintenue entre 1933 et 1937
avant de succomber sous les coups de
la répression, exercée par le régime
nazi disposant d’une force considérable.
Il faut préciser que le réseau est
compatible avec le fédéralisme. Dans
le texte « Fédéréseau », publié dans
le numéro 117 d’Anarchosyndicalisme
!, Jean Picard soutient avec pertinence
l’Idée que le réseau et le fédéralisme
(« Le fédéralisme en réseau
») ne souffre d’aucune aporie,
dans la mesure où l’un et l’autre se
synthétisent. En la contextualisant,
l’expérience de la FAUD peut nous
inspirer. Les anarchosyndicalistes de
la CNT-AIT et autres révolutionnaires
authentiques doivent donc continuer
de s’interroger sur la forme d’organisation
la plus adaptée à la situation
du moment.
Notre but n’est-il pas de potentialiser
au maximum notre force dans l’action
pour détruire le capitalisme et
construire le communisme libertaire ?
Qu’est-ce que la force ? Que l’on me
permette de citer Emile Pouget (théoricien
du mouvement ouvrier) : « La
force est l’origine de tout mouvement,
de toute action, nécessairement, elle
en est le couronnement. La vie est l’épanouissement
de la force, et hors de
la force, il n’y a que néant. Hors d’elle,
rien ne se manifeste, rien ne se
matérialise... ». La force prête son
concours à la liberté ou cette carence
ontologique des Hommes (et non pas
de l’Homme : construction abstraite
de l’humanisme bourgeois qui définit
son éthique). En effet, nous sommes
pourvus de la liberté et nous sommes
condamnés à l’exercer. Celle-ci nous
constitue. Elle détermine les choix
réalisés en fonction d’un but recherché
pour influer sur le cours des choses
; grâce à l’action qui nous pousse
et renforce notre sentiment de puissance
(allant de pair avec la volonté).
C’est ce que nous appelons être en
situation (de manière à amener une autre situation qui rende impossible
tout retour en arrière : la théorie de l’événement).
Cette liberté pose notre
responsabilité à tous devant
l’Histoire ! Dès lors, il s’agit d’avoir
l’intelligence politique de la situation,
puisque nous sommes confrontés à la
réalité de ce monde qui s’impose
(l’objectivité). Autrement dit, il y a
des conditions (c’est-à-dire des limites
et contraintes) qui nous sont faites
indépendamment de notre volonté.
Or, l’action suppose une méthode particulière,
visant également à dégager
les enseignements de l’Histoire pour
annihiler la fausse conscience de soi
(l’ignorance). Quelle est cette méthode
particulière ? La dialectique ! Cette
dernière permet de comprendre qu’une
forme d’organisation est toujours
en devenir jusqu’à ce qu’elle se désintègre,
parce qu’elle est dans cette incapacité
justement à être en situation
pour résoudre les contradictions de la
situation du moment. L’Histoire voit
s’affronter et trépasser les Hommes ;
elle n’est pas le lieu où l’on conte paisiblement
fleurette, son tribunal rend
un verdict sans clémence. Il faut vaincre
ou périr !
Paul Anton